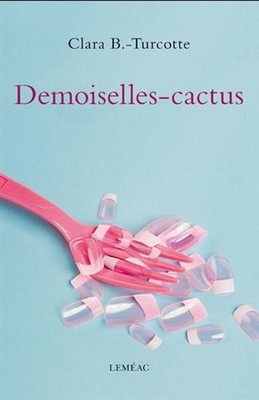Un roman fourre-tout
Dès les premières pages de Demoiselles-cactus, un sentiment d’agacement s’est emparé de moi et il ne s’est jamais éteint, voire estompé, au fil de ma lecture. Celui-ci est probablement intimement lié au personnage de Mélisse, une jeune femme qui passe ses journées à s’examiner et à tout ramener à elle, et aussi au côté fourre-tout du premier roman de l’auteure.
Problèmes alimentaires, pédophilie, sectes, drogues diverses, difficultés relationnelles, tous ces sujets sont abordés dans Demoiselles-cactus, superficiellement la plupart du temps, si bien qu’il est difficile pour le lecteur de s’attacher au personnage principal. Plus difficile encore de croire à ce qu’elle vit. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé de saisir l’essence du personnage, entre les ambiguïtés et les contradictions, les aberrations et les problèmes de construction.
Il ne suffit pas de mélanger divers ingrédients dont la presse aime s’emparer pour que le tout devienne un roman qui tienne la route; Clara B.-Turcotte en fait la démonstration avec Demoiselles-cactus. On sort du roman sans avoir compris où l’auteure veut en venir, d’autant plus que l’extrait du quatrième de couverture, faisant référence à une phrase qui n’arrive que dans les dernières pages, ne reflète en rien le ton et le contenu de Demoiselles-cactus.
Pourtant, Clara B.-Turcotte sait écrire et nous le prouve avec certaines phrases qui ont un fort pouvoir d’évocation. Mais cela n’a pas été suffisant pour que je m’attache à Mélisse, pour que j’accepte de la suivre dans tous les dédales de son univers fait de psys, d’une amie qui habite aux États-Unis, de parents insaisissables, d’un voisin perdu de vue avec qui elle reprend contact, et surtout d’un colocataire bizarre dont elle découvre le goût pour la pédophilie. Trop de voies empruntées, trop de détours qui ne mènent nulle part, trop de sentiments dont on ne voit que la surface des choses, trop de ce qui nous empêche de saisir le mal de vivre de Mélisse.
Nous sommes loin du magnifique roman en partie autobiographique de Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous, publié en 1978, lequel mettait aussi en scène une jeune femme aux prises avec l’anorexie, la pointe de l’iceberg de son désir de mourir.
Pourtant, si l’auteure avait été mieux dirigée, elle aurait peut-être pu faire de Demoiselles-cactus autre chose qu’une suite de petites histoires qui s’imbriquent bien mal les unes dans les autres et dont on sort avec le sentiment d’avoir été floué. Impossible ici de ne pas reprendre la formule « Qui trop embrasse mal étreint ».