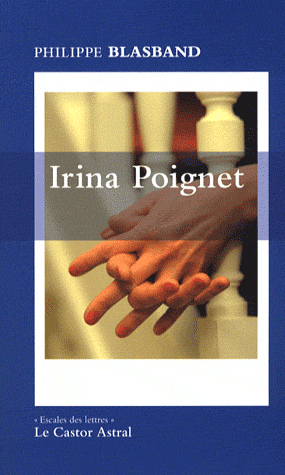Irina Poignet
Elle ne s’appelle Irina que quelques heures par semaine, le temps de gagner suffisamment d’euros grâce à son habile poignet pour défrayer les coûts du médicament onéreux qui va peut-être sauver la vie de son petit-fils, dont ses parents se sont désintéressés. Ce petit-fils qui est tout ce qu’elle a et aussi le seul être à qui elle tienne.
Elle s’appelle Marguerite ou Maguy chez elle, pour ses voisines, à l’hôpital. Pas Irina. Bien que ce prénom et l’activité qui y est reliée ne lui répugnent plus. Malgré le sordide de la chose. Mais il fallait bien trouver une façon de gagner de l’argent raidement. Elle qui avait été hôtesse à la RTBF n’avait jamais touché un clavier de machine à écrire. Encore moins celui d’un ordinateur. Le travail de bureau lui était donc inaccessible.
Elle s’appelle Irina quelques heures par semaine. Et c’est cela que Philippe Blasband raconte. Ces quelques heures dans un endroit de passage pour les filles comme pour les clients. L’amitié entre elles. La compétition. Sans juger. Sans faire le moralisateur.
Et si le geste est beau, si l’auteur ne fait pas un drame de la situation, il s’est tout de même laissé prendre à son propre jeu en s’attachant lui-même à Irina Poignet au point de guérir son petit-fils, dans un premier temps et d’offrir au roman une fin qui n’a (presque) rien à envier aux romans à l’eau de rose.
Mais ces deux irritants ne sont pas assez importants pour détruire la force de ce roman, pas plus que les questions qu’il soulève. Pas assez importants non plus pour qu’on ne s’attache pas à cette grand-mère hors normes, moderne malgré elle.
Lu dans le cadre du Challenge « Littérature belge ».